Les médecins français au Maroc, 1912-1956
La vie quotidienne d'une assistante sociale
dans le Maroc du Protectorat (1950)
Marie-Claire MICOULEAU-SICAULT
Toujours sur le terrain, «une profession qui est aussi un apostolat.» C’est le titre un peu pompeux de l’enquête à propos des Assistantes Sociales en service musulman que le quotidien, Vigie Marocaine, avait publiée les 8, 9 et 10 janvier 1950.
Le chemin n’était pas semé de roses pour les jeunes Assistantes Sociales tout juste arrivées de France et fraîchement diplômées. Leur initiation marocaine allait se faire en deux temps. Six mois de stage à l’École des Hautes Études de Rabat où on leur inculquait des notions de langue arabe, de sociologie et d’ethnographie marocaines. Ensuite, quatre mois d’expérience directe dans les hôpitaux, les postes des Affaires Indigènes, les fermes européennes etc. Et puis, au travail !
Le travail, elles se doutaient bien qu’il leur faudrait persévérance et bonne humeur pour l’aborder, mais elles n’imaginaient sûrement pas quel acharnement elles devaient déployer pour le mener à bien. Surtout, elles ne pouvaient pas deviner de quel esprit d’initiative elles devraient faire preuve, inventant par elles-mêmes des méthodes, puisqu’elles jouaient le rôle de pionnières dans des structures encore balbutiantes.
Le «pas trouvé», excuse facile, n’existe pas pour la jeune Assistante Sociale qui doit non seulement aider matériellement des femmes et des enfants mais aussi quand il s’agit des nouvelles Médinas ou des nouveaux bidonvilles que l’industrialisation fait surgir, découvrir les causes d’un malaise collectif à la fois moral et physique. Fausses ou mauvaises adresses ne doivent pas la désarmer. Elle frappera à toutes les portes, obtiendra parfois le nom de l’employeur, s’adressera aux responsables des quartiers recueillera les indications précieuses qui lui permettront de se faire une idée de l’état de misère plus ou moins grand qui règne dans ces foyers déshérités.
Ce travail ressemblait parfois à des enquêtes, mais toujours pour le mieux-être des populations qui leur étaient confiées et toujours dans le respect des traditions. Les femmes musulmanes ne s’y trompaient pas, qui accueillaient toujours les visiteuses avec douceur et sympathie. Pénétrer au cœur de la misère, atteindre cette vérité sociale si difficile à approcher, sur quels points insérer l’action, il avait fallu des mois pour l’entrevoir et trouver les moyens discrets mais efficaces pour soulager les souffrances.
cet avant-poste de l'assistanat
Visitons avec la journaliste du Maroc Presse du 3/12/1949 le fameux Douar Doum situé à 4 kilomètres au Sud-Est de Rabat. Ce plateau, ainsi nommé à cause des palmiers nains (le doum) qui l’envahissaient, était «couvert de bicoques disparates, agglutinées dans une sorte de cité à la fois très étendue et très friable.» D’après l’Assistante Sociale en chef, environ 10.000 personnes habitaient ce douar, dont une population enfantine importante (environ 30%.) «Une des particularités de ce douar, écrit-elle dans son rapport à la Direction de la Santé, est son caractère familial : il est constitué presque uniquement de tribus venues du Sud, Agadir ou Marrakech qui depuis leur émigration, ont continué à vivre en tribus, à se marier entre individus d’une même tribu. Chez les Aït-Oussa et les Aït-Ahmed, les femmes conservent le costume bleu des femmes du Sud la coiffure très particulière, les bijoux berbères...»

Rabat, infirmerie, ambulance coloniale
La journaliste, qui en 1949, visite ce douar en compagnie des pédiatres, raconte : «Des logements ayant souvent à peine hauteur d’homme, faits de planches, de bouts de tôle ou même de carton [...] L’attitude des habitants n’exprime pas l’accablement ou même la résignation, mais une calme acceptation... À l’orée de Douar Doum, se dresse une tente où nous pénétrons. Deux jeunes filles en blouses blanches soignent les bébés tandis que quelques mères, assises attendent silencieusement. Une grande propreté règne dans cet avant poste de l’assistance où les consultations se succèdent. Quand tombe le soir, les jeunes assistantes travaillent à la lueur d’une lampe à pétrole ou d’une bougie...»
Un rapport d’activité, décrit la population du Douar Doum comme la plus pauvre de Rabat les hommes y sont colporteurs, fleuristes, manoeuvres, «chaouchs» (plantons) à la Résidence. Les salaires ne dépassent pas 8.000 francs mensuels. (soit environ 800 francs actuels) Un seul point d’eau de douze robinets ; les femmes ne sortent pas du douar, elles s’occupent du ravitaillement en eau. Un poste de commandement, modeste baraque, abrite le Contrôleur Civil (fonctionnaire français) et le Khalifa du Pacha qui assurent conjointement l’administration du Douar. Une école foraine accueille environ 300 garçons et 100 filles. Mais beaucoup d’enfants traînent dans les ruelles, malgré la cantine et les onze écoles coraniques. Mortalité infantile énorme, les femmes vivent toujours comme leurs aïeules il y a des siècles.
C’est en Juillet 1949 qu’après plusieurs essais de consultations itinérantes, furent installées en bordure du douar deux tentes américaines, «embryon d’un futur centre de PMI.» Un pédiatre une fois par semaine, une sage-femme, et tous les jours une assistante sociale pour les soins aux enfants. Là aussi, un fichier devient une amorce d’état civil : 300 fiches d’enfants jusqu’à deux ans. Les consultations ne suffisent plus, des visites à domicile sont demandées par le médecin pour la surveillance à la maison de l’alimentation et de l’hygiène des nourrissons.
Des visites sont aussi demandées par la famille lors de la naissance d’un enfant, elles permettront de suivre le bébé dès sa venue au monde. Les Assistantes Sociales sont en plus chargées de liaison avec les dispensaires antituberculeux et anti-vénérien, cas douteux suivis ensuite par l’Assistante. Pendant le temps qui leur reste, (mais quand dorment-elles?) elles rencontrent le Khalifa et le Contrôleur Civil pour coordonner les actions, puis elles assurent la liaison avec l’école foraine qui signale ainsi les enfants déficients ou malades.
Avant d’avoir pu mettre en place cette sorte d’organisation somme toute compatible avec les moyens toujours augmentés mais jamais suffisants, il faut bien dire qu’elles «pataugeaient», s’adaptant au jour le jour et parfois désespérées. Une expérience, intéressante à plus d’un titre, nous est rapportée par Françoise Setin et Régine Gautier, Assistantes Sociales dès 1947 à Agadir. En 1947, les usines de conserves de sardines s’étaient développées considérablement à Agadir et le besoin de main d’œuvre s’y faisait pressant. Les directeurs des sardineries firent donc appel aux populations de la région de Goulimine et des environs de Mogador (Essaouira). Seules les femmes avaient le droit de travailler, les hommes se réservaient le privilège de rester au bled pour les travaux divers.
une "école des mères"
Ce furent des femmes bleues de Goulimine et des femmes des tribus chleues de Mogador qui arrivèrent en premier avec leurs enfants. Dans ce qu’on appela des «médinas d’usine», elles furent logées dans les fameuses tentes noires pointues, au milieu des collines de sables cernées d’euphorbes. Regroupées par tribus, elles se retrouvaient presque comme chez elles sous l’autorité d’un cheikh, toujours vêtues mais non voilées de leur haïk bleu. Si les étoffes ne déteignaient pas sur leur visage et sur leur corps, elles perdaient la «baraka»! (protection de la providence).

femmes bleues de Goulimine (années 1970)
On imagine les difficultés des assistantes sociales, confrontées à ce teint bleuâtre, pour diagnostiquer une quelconque pathologie ! Elles ne désarmaient pas, ces jeunes assistantes, éblouies par «ces longues files de femmes magnifiques, au port de reines, qui rapportaient sur leur tête, pour leur dîner, à défaut d’amphores, des boites de sardines en fer blanc.»
Le service médico-social débuta en 1949 à Khiam-Battoir et en 1950 à Anza. Des tentes, puis des baraques abritaient une infirmerie, des consultations de nourrissons et une «école des mères» avec démonstrations alimentaires, garderies pour les enfants où les filles apprenaient ainsi à tricoter, à baigner les petits frères, à les nourrir du mieux possible. En 1954, des locaux neufs remplacèrent tentes et baraques et la Protection Maternelle et Infantile était désormais presque idéale. À la garderie, il suffisait qu’un des enfants frappe en cadence sur une cruche, «une guedra», et les petites se mettaient à genoux pour danser en ondulant leurs bras.. C’était si beau !
Mais les difficultés ne manquaient pas : certaines des nomades dans l’âme, se sauvaient de l’hôpital ou bien, orgueilleuses, elles ne supportaient pas une remontrance à propos de leur travail à l’usine. «Aussitôt, l’interpellée se levait sans un mot, et partait suivie de toutes les bleues de sa table sous l’œil ahuri du contremaître chleu.» Les histoires de maléfices, les serments à mort «à Sidi Saanoun» les «chikayas» (querelles) de toutes sortes, venaient empoisonner la vie quotidienne des pauvres assistantes.
D’ailleurs, les hommes chleuhs qui n’aimaient pas beaucoup les populations bleues répétaient le proverbe : «Qu’un homme de Mauritanie demande en mariage une femme là-bas, il ne demande pas comme chez nous si elle sait faire la cuisine et s’occuper de la maison, il demande seulement si elle sait bien. Plus tard, leurs maris se résignèrent à venir travailler. Impressionnés par les jolis bâtiments neufs de l’hôpital et par les Arabes et les Chleuhs, ils se taisaient mais gardaient leur sourire énigmatique et fier.
la toubiba...
La pauvre Assistante sentait que le ravissement des découvertes s’effaçait peu à peu, noyé par les difficultés du quotidien! Qu’importe, on était là pour travailler! Chaque région offrait aux jeunes assistantes un visage différent ; un douar du Sous n’avait rien à voir avec la Médina «Jdid» de Fez et le bidonville du Douar Doum était lui aussi bien différent des services sociaux de Casa.
On improvisait selon les besoins, on essayait une méthode, on testait... telle cette invention fabuleuse du «flanellographe» que connaissaient déjà bien les éducateurs sanitaires d’Afrique. Elle avait été imaginée en pays africain anglophone et diffusée par le Centre International de l’Enfance de Boulogne. Il s’agissait de dessins découpés dans de la flanelle que l’on punaisait au mur de «l’école des Mères», pour expliquer comment baigner un bébé, préparer un biberon, puis au fur et à mesure des progrès enregistrés, comment désinfecter les yeux des enfants. Les femmes musulmanes, nous l’avons dit, devaient être promues «prolongement de la Toubiba.»
Marceline Gabel, dont nous avons parlé, utilisa cet outil pédagogique fort efficace et qui plaisait aux mamans élèves. Colette Brémond, une Assistante Sociale qui parlait bien l’arabe dialectal, fut chargée de mettre en place une causerie hebdomadaire sur Radio-Maroc, où, répondant aux questions d’une jeune femme marocaine, elle prodiguait conseils pratiques et médicaux (comment préparer un biberon de la manière la plus stérile possible, que faire en cas de diarrhée d’un bébé, etc.).
Cette causerie eut beaucoup de succès auprès des Musulmanes qui, ne sortant pas, se réunissaient pour papoter l’après-midi autour du verre de thé à la menthe. Les questions les plus diverses étaient posées et les problèmes les plus insolites soulevés. Une sorte de chronique médicale, la «toubiba» de la radio était très écoutée. Des années plus tard, elle était devenue Assistante Sociale d’Entreprise en métropole, allant visiter un malade marocain hospitalisé à Paris, elle eut la surprise d’être ainsi accueillie. «Ah ! mais je reconnais ta voix, toi, tu étais la «toubiba» de la radio!».
Marie-Claire Micouleau-Sicault
- sur Études Coloniales, le livre de Marie-Claire Micouleau-Sicault
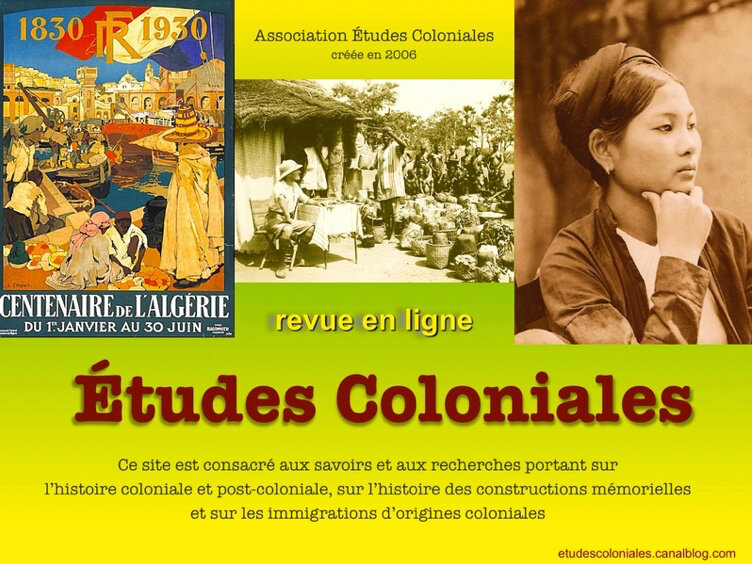

/httpsstorage.canalblog.com04981133627169458_o.jpg)
/httpsstorage.canalblog.com9697113362134487132_o.jpg)
/httpsstorage.canalblog.com2578113362134071052_o.jpg)
/httpsstorage.canalblog.com8819113362133839148_o.png)
/httpsassets.over-blog.comtcedisticcamera.png)